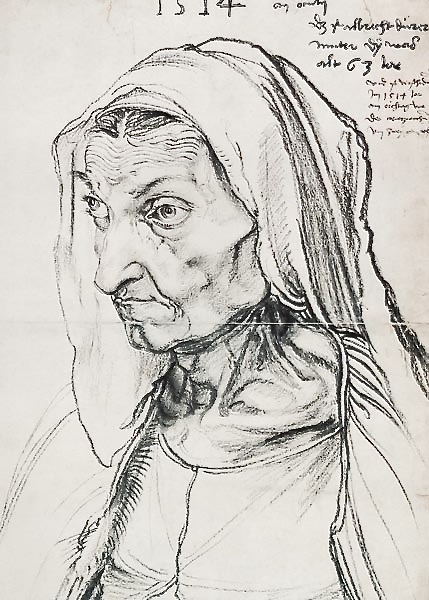Marilyn Monroe photographiée en 1956 par le réalisateur Joshua Logan chez le producteur William Goetz qui possédait une version de La petite danseuse de Degas

Marilyn Monroe photographiée en 1956 par le réalisateur Joshua Logan chez le producteur William Goetz qui possédait une version de La petite danseuse de Degas


Un bruissement de feuilles
Une note cristalline
L’élégance du trait
Une place, un peintre …

Cette huile sur bois de pin conservée au musée des Offices à Florence démontre comment Dürer s’est approprié les couleurs de Venise.
Dürer s’est représenté au centre du tableau, vêtu en vert.
 Cette tempera sur toile de Mantegna est conservée à Berlin
Cette tempera sur toile de Mantegna est conservée à Berlin
à la Gemäldegalerie
 Cette huile sur bois est une reprise de la composition de Mantegna par son beau-frère, Giovanni Bellini. Elle est conservée à Venise
Cette huile sur bois est une reprise de la composition de Mantegna par son beau-frère, Giovanni Bellini. Elle est conservée à Venise
à la Fondation Querina Stampalia.
Dürer s’est inspiré de cette composition pour son tableau
Jésus parmi les docteurs